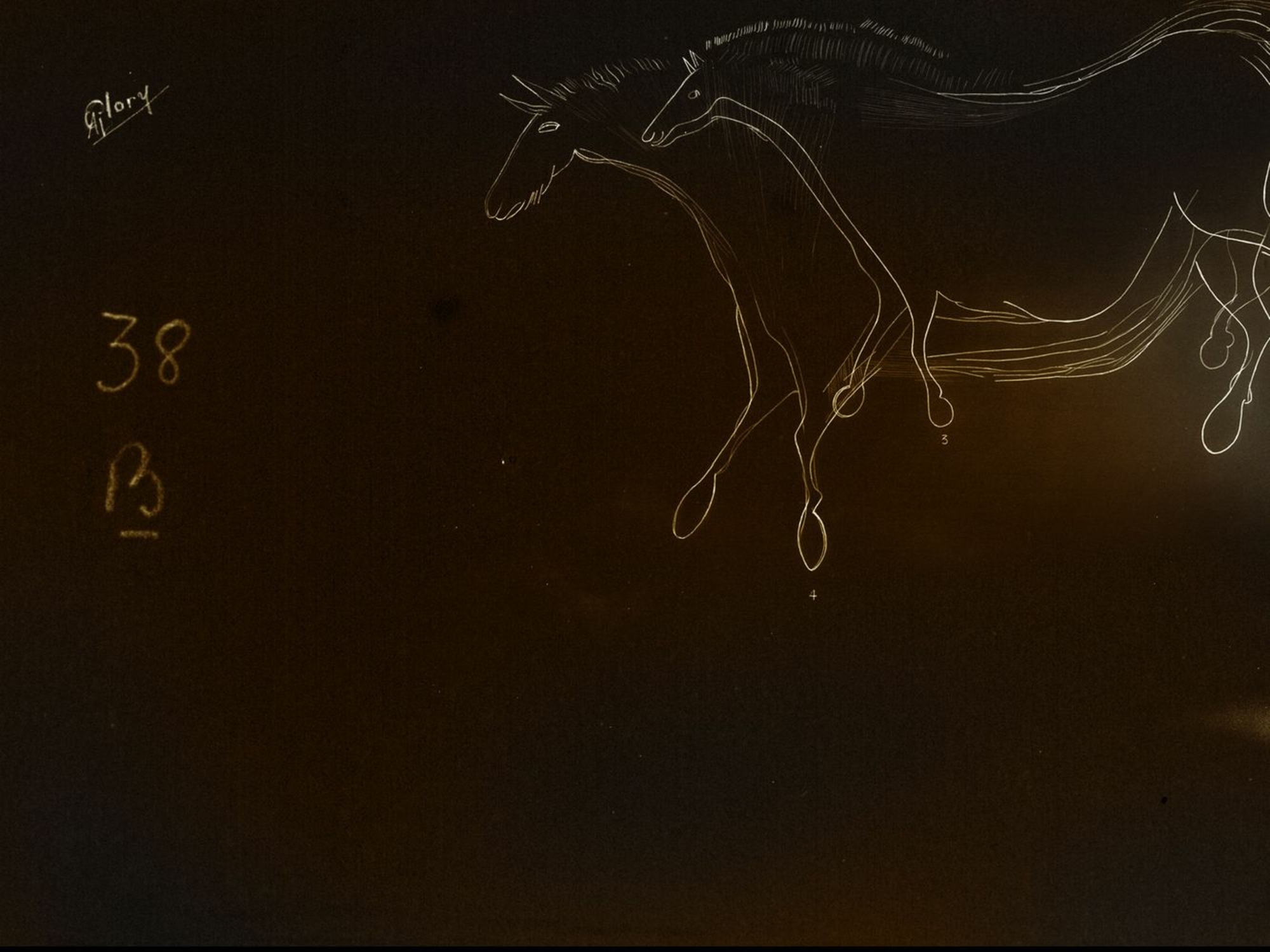- Accueil
- Les recherches archéologiques
- Datation des figures de Lascaux
Les premières propositions chronologiques
Au lendemain de la découverte, Henri Breuil et Denis Peyrony établirent tous deux une relation avec le Gravettien. Pour Breuil, la chronologie de l’art pariétal paléolithique reposait sur l’existence de deux cycles, l’un aurignaco-périgordien, l’autre solutréo-magdalénien. Il rapprocha de Lascaux les figures peintes sur des blocs trouvés en stratigraphie – et donc bien datés – de l’abri Labattut (Périgordien) et de l’abri Blanchard (Aurignacien), Une évaluation plus nuancée fut effectuée par Annette Laming, qui fit remarquer que cette iconographie montrait autant de caractères pouvant être attribuables à l’un ou à l’autre des deux cycles majeurs.
Pour Séverin Blanc, une majorité d'indices tendaient à attribuer à une partie de cet art une origine plutôt solutréo-magdalénienne.
Premières datations radiocarbone
En 1951, des fragments de charbons de bois issus des fouilles du Puits furent analysés à Chicago, dans le laboratoire du Dr. W. Frank Libby, l’initiateur de la méthode. Les résultats apportèrent de nouveaux arguments en faveur de la dernière proposition. La date obtenue, située autour de 19 mille ans avant le présent (15 516 ± 900 BP), plaçait Lascaux dans la culture magdalénienne.
André Glory fit dater de nouveaux échantillons de charbons de bois, prélevés au cours de ses fouilles dans le Passage et dans le Puits, qui donnèrent des âges situés entre 21 et 18 mille ans BP (17 190 ± 140 BP et 16 000 ± 500 BP), dates confirmant l’attribution du mobilier à une période ancienne du Magdalénien.
André Leroi-Gourhan, s’appuya sur des données stylistiques ; les sites du Fourneau du Diable, à Bourdeilles (Dordogne) et de Roc-de-Sers (Charente), considérés comme bien datés, servirent d’éléments de référence. Ils lui permirent de rattacher Lascaux au Solutréen. Cependant, quelques années plus tard, l’étude du mobilier lithique et osseux, ainsi que l’analyse stratigraphique des coupes pratiquées par André Glory, apportèrent des modifications à ce schéma. Les travaux, dirigés par Arlette Leroi-Gourhan et Jacques Allain, précisèrent et resserrèrent l’estimation chronologique et l’ensemble de Lascaux fut attribué au Magdalénien II. André Leroi-Gourhan se rallia à cette proposition.
Ces ajustements successifs montrent les difficultés rencontrées pour établir un diagnostic précis, suffisamment argumenté.
1998, 2002, nouvelles analyses
En 1998, puis en 2002, deux datations radiocarbones réalisées par le biais d’une nouvelle méthode (datation par spectrométrie de masse par accélérateur, dite « SMA ») à partir de fragments de baguette de bois de renne issu des fouilles de Henri Breuil et Séverin Blanc, tendent à vieillir les dernières estimations, avec un âge situé entre 23,5 et 22 mille ans avant le présent (18 600 ± 190 BP et 18 930 ± 230 BP), à la charnière du Solutréen supérieur et du Badegoulien.
Menée par Norbert Aujoulat, l’analyse formelle des figures de Lascaux lui donne à penser que cet art appartiendrait à une tradition solutréenne. De toute évidence, elles évoquent davantage les œuvres du Fourneau-du-Diable ou de Roc-de-Sers, dont l’attribution au Solutréen est discutée, que tout autre exemple du Magdalénien classique.
Parmi les associations de figures, les Bouquetins affrontés, dessinés sur la paroi droite à l’extrémité du Diverticule axial, ne sont pas sans rappeler ceux, en bas-relief, du Roc-de-Sers (Charente). On peut aussi évoquer, dans ce même site du Solutréen supérieur, l’image rare de l’homme opposé à un animal cornu, dans ce cas un bœuf musqué, semble-t-il, ou un bison. La même scène est reproduite à Lascaux, au fond du Puits. On remarque aussi la présence d’un oiseau dans ces deux sites.
Dépasser les contradictions : le projet LAsCO (2018-2021)
Le bilan réalisé vingt ans plus tard est déroutant : des assemblages aux caractéristiques « magdaléniennes », un style pictural « solutréen », deux séries de dates contradictoires, elles-mêmes réalisées sur des matériaux différents. Ainsi, l’interprétation de ces contradictions se heurte aujourd’hui à une série de questions et d’incertitudes archéologiques et méthodologiques : quelle est la pertinence du postulat de synchronicité de l’ensemble ? Quelle valeur accorder à nos critères d’attribution culturelle ? Jusqu’à quel point peut-on tirer parti de la comparaison de datations réalisées à cinquante ans d’intervalle à partir d’échantillons et de méthodes distincts ?
Le projet LAsCO (Langlais et Ducasse coord.) a réinvesti ces questions à travers une réévaluation collective et interdisciplinaire de l’ensemble du matériel archéologique retrouvé dans la grotte. Ce projet a donc naturellement motivé la mise en place d’un nouveau programme de datation 14C dont les premiers résultats ont été récemment divulgués à la communauté scientifique, publiés dans la revue PALEO. Ces nouvelles données chronologiques, obtenues à partir de la datation de plusieurs fragments osseux de renne issus des principaux secteurs de la cavité, sont en parfaite cohérence avec les hypothèses d’attribution culturelle parallèlement formulées sur la base de l’étude des outillages en pierre et en bois de cervidé. Les vestiges matériels abandonnés dans la grotte résulteraient donc d’une (ou de plusieurs) occupation(s) située(s) quelque part entre 21,5 et 21 mille ans avant le présent, c’est-à-dire lors d’une phase charnière entre les traditions culturelles du Badegoulien (23-21 mille ans avant le présent) et du Magdalénien (21-14 mille ans avant le présent).
La fréquentation de la grotte est ainsi rajeunie de 1000 à 1500 ans par rapport aux âges obtenus à la fin des années 1990, âges sur lesquels une partie de la communauté scientifique s’appuie pour rattacher tout ou partie du dispositif pariétal de Lascaux au Solutréen supérieur (circa 24-23 mille ans avant le présent). Cette étape est d’autant plus importante que, si l’on a fêté, en 2020, les 80 ans de l’existence « moderne » de la grotte – à la fois comme sujet d’étude, d’interrogation et d’émerveillement – les scientifiques n’ont cessé, depuis, de chercher à percer l’énigme de son âge réel…
De quand date la grotte de Lascaux ?
La grotte de Lascaux date d'il y a 23 000 ans (entre 23 500 et 22 000 avant le présent), à la charnière de la période dite du Solutréen supérieur et du Badegoulien.
Qui a peint les peintures de la grotte de Lascaux ?
Ce sont les hommes et les femmes de la Préhistoire, de la culture solutréenne, qui ont peint les parois de la grotte de Lascaux.
Médias associés
Accéder à la médiathèque